
Rencontre avec Armel Job, auteur et observateur
Armel Job : conscience et culture
Publié le 5 janvier 2010, par
Né en 1948, à Heyd, près de Durbuy dans un milieu modeste d’artisan, Armel Job fait aujourd’hui partie des auteurs belges qui comptent. Après avoir enseigné le latin et le grec à l’Institut Notre Dame de Bastogne, il en devient le Directeur en 1993. Cette nouvelle fonction coïncide avec son entrée en écriture. Il a aujourd’hui à son actif une douzaine de romans dans lesquels il chemine avec finesse, humour et tendresse sur les chemins tortueux de l’inviolable conscience humaine.
Dehors il pleut des cordes. Dans son bureau qui bruisse des mille rumeurs d’une journée de classe, Monsieur le directeur nous raconte son métier d’écrivain et nous partage quelques convictions : sa foi libre, son souci de transmettre aux jeunes un héritage culturel, sa passion pour la langue française... Et donne le sens du tout récent déménagement de la bibliothèque au cœur même de son établissement...
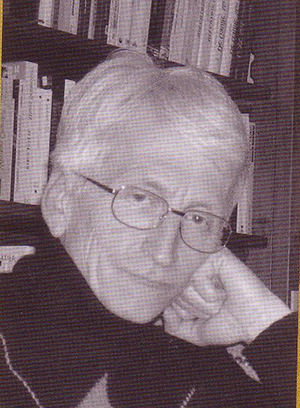
G.D. Pourquoi, Monsieur Job, être venu si tard à l’écriture ?
A.J. En fait, j’ai commencé à écrire quand je suis devenu directeur. Comme enseignant, je n’avais jamais publié quoi que ce soit. Quand j’étais professeur il m’arrivait de produire quelques textes pour mes élèves, pour des revues... J’aimais aussi écrire des nouvelles et ce genre littéraire me plaisait.
Quand en 1993 je suis devenu directeur, j’ai vraiment eu l’impression que me manquait ce que j’avais fait pendant vingt ans avec mes élèves : parler, m’interroger, poser des questions au cœur d’une relation où l’on partage le plaisir commun d’apprendre. Mais comme directeur, la relation pédagogique avec les élèves est forcément réduite à peu de choses. Je me suis alors mis à écrire et, sans d’ailleurs que j’en sois vraiment conscient, je retrouvais dans l’écriture mes sensations de professeur en train de préparer ses cours. Ecrire des romans a donc d’abord été pour moi une activité qui remplaçait en quelque sorte le travail pédagogique.
G.D. Pourtant, être romancier ce n’est pas s’adresser à une classe... }
A.J. Non bien sûr, mais pour moi le romancier doit s’adresser en permanence à ses lecteurs, les avoir toujours devant les yeux. Et donc, d’une certaine façon, ce sont mes lecteurs qui forment ma classe ! Car je ne suis pas un romancier qui fait de l’introspection, qui parle de lui, tout en respectant évidemment ceux qui fonctionnent de cette manière-là. La définition du romancier qui me convient le mieux c’est celle de Giono : « Le romancier est un raconteur d’histoires » : je suis dans la vie, j’observe ce qui m’entoure ... Bien sûr, j’invente la réalité, mais ce sont des possibles de la réalité. Ce qui m’intéresse, c’est la vie, les gens et ce qu’ils pensent, ce qu’ils ont dans l’âme, dans le cœur... Mes personnages, je les questionne sans cesse. Le roman pour moi c’est une question posée pour comprendre.
G.D. Précisément, les personnages que vous scrutez ainsi dans vos romans, gens simples et notables, semblent bien complexes, offrant des facettes souvent inattendues...
A.J. Vous savez... quand on commence à chercher comment et pourquoi les gens agissent, on s’aperçoit que tout le monde agit de manière très complexe. Et quand on travaille sur un roman, c’est la découverte que l’on fait en permanence. Si vous passez beaucoup de temps à méditer sur les personnages que vous allez créer, à réfléchir à ce qui s’est passé dans leur vie et comment ils vont réagir, vous constatez que tous les êtres humains sont extrêmement complexes. Finalement, le romancier fait, de manière plus systématique, le travail qu’on devrait toujours faire quand on réfléchit aux relations humaines.
Quand j’entreprends un roman, je pars toujours d’une idée d’histoire et dans un deuxième temps je commence à penser à mes personnages. Et je constate à chaque fois, que je pars d’abord avec une idée assez stéréotypée de mes personnages.
G.D. Pouvez-vous préciser un peu ?
A.J. A priori et presque inévitablement, je vais avoir tendance à croire que les gens modestes sont sympathiques, honnêtes, travailleurs... parce que cela fait partie de mon expérience. Et à l’inverse, j’aurai spontanément un peu plus de méfiance par rapport à quelqu’un qui appartient à la bourgeoisie. Mais justement, tout mon travail de romancier, c’est cette méditation que je m’impose et qui s’impose à moi quand j’essaie de comprendre pourquoi et comment agissent les gens que je mets en action. Et je m’aperçois que c’est extrêmement compliqué car nous sommes un tissu de contradictions. D’ailleurs, le lecteur va être associé à cette recherche puisque lui aussi part d’une image caricaturale du personnage. Petit à petit, il va s’apercevoir qu’il l’a sans doute mal jugé. Le roman est un dévoilement progressif de la complexité des personnages.
G.D. Peut-on dire que vos personnages vous apprennent sans cesse quelque chose sur la vie ?
A.J. Oui, bien sûr... Je peux dire que chaque roman m’a appris quelque chose. Le roman ça ne consiste pas seulement, comme on pourrait se l’imaginer de l’extérieur, à faire des phrases, à noircir le nombre de pages prévues au contrat... Pour moi, c’est d’abord penser, réfléchir, méditer. Le romancier a la chance extraordinaire de pouvoir méditer tous les jours. Il a choisi naïvement un sujet et pendant toute une année, chaque jour, il le considère sous tous ses angles ; il repense sans cesse à ses personnages, parfois il se prend d’affection pour eux au fil de son travail, il évolue avec eux, il rectifie le tir (Je pense à l’évêque dans Les mystères de Sainte Freya : malmené au début, saisi à partir de son enfance ensuite, perplexe et plus humain à la fin). Car au bout du compte l’auteur ressort lui-même perplexe de ce qu’il a essayé de raconter. C’est ça qui est intéressant dans le travail de création. C’est aussi la raison pour laquelle je ne peux travailler qu’un seul roman à la fois. J’ai besoin de vivre longtemps avec mes personnages.
G.D. D’où des romans qui accumulent les rebondissements, les révélations et les surprises...
A.J. C’est vrai mais il ne s’agit pas d’un simple artifice littéraire. Encore une fois, ce sont mes personnages qui surprennent et que j’interroge : comment vivent-ils l’événement, que ressentent-ils ? C’est cela qui m’importe. Un romancier que j’aime beaucoup à cet égard, c’est Milan Kundera. C’est aussi un romancier qui détruit les stéréotypes, qui questionne. Les personnages de ses romans ne sont pas prisonniers d’une certaine psychologie qu’on aurait comprise au bout d’une vingtaine de pages. C’est très frappant chez lui.
G.D. Cela signifie-t-il alors que le romancier ne maîtrise rien...?
A.J. Oui et non... Je me méfie de ce genre d’affirmations, comme si les personnages pouvaient totalement échapper à l’auteur. Il serait absurde de dire qu’ils ont une vie totalement autonome. Ou alors, je ne serais qu’un simple observateur de ce que je crois être la réalité. Les personnages sont toujours nos créations mais, au fur et à mesure du travail d’écriture, ils deviennent de plus en plus complexes et donc me surprennent. Mais j’imagine qu’un mathématicien est lui aussi surpris par ce qu’il découvre au fil de sa recherche... Ca ne veut pas dire que l’action est extérieure au romancier. Elle vient quand même de lui.
G.D. Vous maniez volontiers l’humour dans vos textes. Serait-ce une manière de mettre à distance des émotions ? Une façon singulière de regarder la vie ?
A.J. Presque inévitablement si vous choisissez de raconter une tranche de vie, vous êtes dans une situation de spectateur, d’observateur. Donc, cette distance existe automatiquement. C’est l’attitude saine du romancier en tant que « raconteur d’histoires » qui regarde la vie. Et il est bon que le romancier rappelle au lecteur qu’on est des observateurs et qu’on n’est pas dupes de ce qui se passe. Que le petit travers observé, on le regarde avec sympathie. Je n’aime pas, en effet, l’ironie méchante. J’aime bien un partage humoristique avec mon lecteur. Je lui fais un petit clin d’œil... et de cette manière-là, je dialogue avec lui ; cela me permet de me rappeler à son bon souvenir. Je pense aussi que ces petits traits d’humour sont un témoignage de respect : on traite le lecteur comme quelqu’un d’intelligent. C’est important, parce que cela établit une certaine connivence, une certaine « fraternité » entre nous.
G.D. Et l’amour des mots, la recherche du terme juste, original, d’où cela vous vient-il ?
A.J. Dès l’enfance, j’ai beaucoup aimé le Français. J’éprouvais une véritable fascination pour la langue. Et surtout j’ai très vite senti la magie des divers niveaux de langage. Je me souviens que dans la petite école de mon village (six classes avec un instituteur) chaque événement était l’occasion d’un exercice de rédaction. Par exemple si la neige commençait à tomber, l’instituteur nous demandait quelques lignes. On commençait par écrire des banalités. Mais le maître alors nous enseignait la métaphore : la neige était comme de l’ouate, les fils comme une portée de musique, les oiseaux se changeaient en notes, les arbres devenaient des fantômes... Je trouvais absolument fascinant que les mots de tous les jours puissent ainsi prendre une tout autre dimension. J’ai donc contracté ce virus de l’amour pour le langage dans mon enfance. Par la suite, j’ai étudié la philologie, enseigné le grec et le latin dont j’ai admiré la douceur et les rythmes, j’ai aimé faire des traductions... J’ai donc travaillé toute ma vie sur la langue et comme romancier je continue évidemment. Mais pas pour « faire beau ». André Gide conseillait d’ailleurs à Simenon : « Pas de littérature ! ». Pour moi il faut rendre les choses de la manière la plus juste possible par rapport au sujet que l’on traite. Mais une métaphore doit être justifiée.
G.D. Observateur avec humour, distant et surpris... le raconteur d’histoires s’implique-t-il d’une façon ou d’une autre ?
A.J. C’est une grave question. Pour moi, il n’y a rien de pire pour un romancier que de vouloir donner des leçons. Je ne vois pas au nom de quoi je le ferais. Je sais comme tout le monde que la vie est compliquée. Donc il n’y a pas de morale au sens strict dans mes romans. Mais il se peut, tout compte fait, que j’amène mes lecteurs à s’interroger et à suivre le principe qui sert de titre à mon dernier roman : Tu ne jugeras point. Il ne faut pas juger trop vite ni condamner sur les apparences : quand on écrit un roman, c’est une leçon qu’on tire inévitablement de la fréquentation assidue des personnages.
G.D. Quand des critiques vous comparent à Simenon...?
A.J. C’est évidemment flatteur. Mais si l’on me compare à lui, c’est parce que c’est aussi quelqu’un, me semble-t-il, qui était très intéressé par les gens, surtout les gens modestes. J’aime moi aussi les gens modestes. Je suis né dans ce milieu dont j’ai toujours gardé la nostalgie, c’est ce milieu que je ressens le mieux. De sorte que l’on pourrait dire que c’est la même atmosphère psychologique. Mais en dehors de cela, je ne pense pas que nous ayons vraiment la même philosophie. Il appartient à une époque où le roman était désespéré et il y a chez lui une certaine noirceur... Je ne partage pas cette vision du monde.
G.D. Pourriez-vous justement nous en dire quelques mots... ?
A.J. Bien...Je ne peux pas dire que j’ai la foi du charbonnier, mais je pense que je suis un homme très religieux. J’ai reçu une éducation religieuse contre laquelle je me suis parfois révolté. Mais si on élimine ces questions-là, il me semble qu’il y a un appauvrissement considérable de l’existence. Ce sont pour moi les questions fondamentales de la vie. Je garde pourtant ma liberté de pensée et j’essaye de ne pas les aborder selon le schéma habituel... Comme dans La femme de St Pierre, par exemple : ce sont des scènes évangéliques. Certains ont dit qu’elles étaient iconoclastes mais pourtant il n’y a pas une phrase qui contredise ce que nous dit l’évangile. Et je n’ai jamais voulu scandaliser. De nouveau, j’ai seulement essayé de comprendre ce qui s’était passé à l’époque, comment ces gens-là avaient perçu le Christ mais en essayant de prendre un angle d’attaque différent de l’angle conventionnel. Personne en effet ne s’est jamais demandé ce que la femme de St Pierre pensait non seulement de son mari, mais aussi du Christ lui-même. Or cela me paraît essentiel. Pour moi, la perplexité est le fondement de l’attitude religieuse : « Comment donc est-ce que tout cela fonctionne ? »...
G.D. Vous êtes aussi directeur d’un établissement scolaire important. Quelles sont les convictions qui vous animent dans votre tâche quotidienne ?
A.J. Pour tenter de répondre partiellement à votre question, je me permets d’abord un constat plus global. Je suis un directeur qui termine sa carrière. Et j’avais à cœur de l’achever par le projet de la nouvelle bibliothèque inaugurée fin octobre. Pourquoi ? Parce que je pense que depuis quelques années dans l’enseignement, la chose écrite -et plus largement ce qui est culturel- a été battue en brèche par les nouvelles techniques d’enseignement. Je ne m’en prends évidemment pas ici à l’ordinateur. Mais on est passé à une pédagogie dans laquelle on met un peu à l’écart la tradition, la culture, le savoir. A un moment, on s’est même demandé si on pouvait encore parler de « savoir » dans les écoles... Tout cela au profit des compétences, c’est-à-dire l’habileté à trouver des solutions, l’aptitude à résoudre des problèmes. On dirait que le monde est né ce matin et qu’on amène sur la table de l’élève une série de problèmes en lui disant de trouver la solution. Bref, une pédagogie qui sollicite beaucoup l’intelligence, ce que je ne conteste absolument pas dans le principe mais...
G.D. Etait-ce différent autrefois ?
A.J. Oui, car dans l’enseignement tel qu’on l’a conçu pendant des siècles, on n’exigeait pas de l’élève qu’il soit intelligent. On lui demandait surtout d’assimiler ce qui avait été pensé par les autres ; de s’imprégner de la culture accumulée au cours des siècles. Et le maître était là pour expliquer, dans tous les domaines et pas seulement en littérature, ce que les générations précédentes avaient trouvé. On livrait donc une certaine tradition. C’était un travail de « civilisation » très important : l’enfant qui sortait d’une école avait pris contact avec la civilisation du monde dans lequel il vivait. Il était probablement moins habile à résoudre les problèmes que les jeunes d’aujourd’hui, mais il y avait en lui cet héritage qui pouvait lui donner le sens de sa place dans la société ou même dans l’histoire... Il voyait bien d’où il venait et ce que la société attendait de lui. Je pense qu’aujourd’hui, on a fortement rejeté cet aspect de l’enseignement. Avec évidemment cette justification que le monde évolue tellement vite, que ce qui compte c’est de pouvoir s’adapter. Il faut surtout être branché sur l’avenir ; le passé c’est le passé.
G.D. Vous trouvez cela regrettable ?
A.J. Oui, je pense qu’il est dommage qu’on laisse tomber la tradition de cette façon. Et que ça crée beaucoup d’insécurité psychologique chez les jeunes. Quand j’ai commencé à enseigner dans les années septante, il y avait dans les écoles une catégorie d’élèves qui a très largement disparu aujourd’hui : celle des élèves révoltés. Ceux qui ne « voulaient » pas assimiler la tradition qu’on leur proposait, qui se faisaient renvoyer... Mais ils connaissaient cette tradition, puisque c’est à elle qu’ils s’opposaient. Aujourd’hui, comme directeur, je cherche un élève révolté. Mais en revanche, c’est incroyable le nombre de jeunes en dépression que je rencontre chaque année. Pourquoi ? Parce que rien ne les intéresse ; ils ne voient pas ce que la vie a d’excitant, tout leur a été donné avec facilité. Pas besoin de s’opposer... Et donc, {{}} Souvent de manière trop catéje me demande si on ne crée pas un monde sans repères, repères que dans ma génération on nous transmettait.gorique certes, surtout en matière religieuse par exemple. Mais aujourd’hui, on dirait qu’on a peur de ces cadres, de la culture même, et de cette forme de culture qu’est la tradition religieuse....
G.D. Vous exprimez-là une certaine conception de l’enseignement aujourd’hui. Qu’en est-il plus spécifiquement selon vous de l’enseignement chrétien ?
A.J. Je pense que c’est dans ce sens-là que l’enseignement catholique doit évoluer. Je crois qu’on ne peut plus avoir un enseignement dit catholique parce qu’il y a des rites catholiques dans l’école, comme au temps où l’école était quasi une paroisse. Aujourd’hui les élèves viennent chercher un enseignement. C’est donc par l’enseignement que nous devons nous positionner comme école catholique.
Je donnais récemment quelques exemples aux professeurs. On dit souvent : « Les valeurs chrétiennes et laïques sont les mêmes ». Je ne suis pas du tout d’accord avec ça. Dire qu’il faut respecter les droits de l’homme, c’est une chose. Se trouver invités par l’évangile à aimer notre prochain « comme soi-même » ou « à aimer nos ennemis », c’est quand même une tout autre dimension. On passe d’un système juridique à la dimension de l’être tout entier. On ne parle plus seulement de sa position en droit mais de sa position en tant que personne. On peut donc aussi rappeler sans rougir que les droits de l’homme s’inscrivent dans la « culture » chrétienne (ils n’existent d’ailleurs pas comme tels dans d’autres cultures).
Je crois donc que dans notre enseignement, nous devons bien évidemment viser à l’acquisition des compétences, mais aussi constamment rappeler l’importance de cette culture dans laquelle le christianisme a quelque chose de très important à dire et à transmettre..
G.D. Quelles réactions suscite parmi les enseignants une pareille conviction ?
A.J. J’ai le sentiment que, faute d’informations, ce discours passe pour être presque « révolutionnaire ». Pour beaucoup, le discours « chrétien » se réduit à la question sur « la messe du dimanche ». Non seulement ça ne me regarde pas, c’est affaire de liberté. Mais en plus ce n’est pas le problème. Mon problème c’est : « Je suis un enseignant dans une école chrétienne. Qu’est-ce ça peut encore signifier ? » C’est pourquoi, j’engage mes professeurs à l’honnêteté intellectuelle. Nous ne sommes pas des demeurés. Je crois que nous avons des choses humainement et culturellement importantes à partager. Je trouve donc essentiel d’aborder le caractère chrétien, par l’enseignement. Un exemple : toutes les trois semaines on affiche dans le grand hall un choix de paroles percutantes de l’évangile, par exemple la paille et la poutre. Pas besoin d’être un chrétien convaincu pour en percevoir la pertinence quotidienne. Et chaque semaine, je propose aux professeurs un feuillet pédagogique qui suggère des pistes pour exploiter cette parole évangélique de manière éducative. Car nous sommes un établissement d’enseignement, pas une maison de prière à l’ancienne.
G.D. L’inauguration de la nouvelle bibliothèque dans le chœur de l’ancienne chapelle s’inscrit-elle dans cette réflexion d’ensemble ?
A.J. Effectivement. Nous avions déjà une bibliothèque, comme un appendice à l’école. Donc, pour moi, remettre une bibliothèque très excentrée jusque là, au centre même de l’école, dans un beau lieu hérité du passé, le lieu le plus prestigieux de l’école, c’est déjà à titre symbolique, rappeler que le lieu de prestige dans l’école, c’est le lieu où se trouve le livre et que le livre doit rester essentiel dans l’école. C’est peut-être simplement symbolique, mais ça me paraît très important. Lors de l’inauguration, j’ai tenté de bien préciser le sens de cette bibliothèque : la volonté de maintenir dans l’école un lieu où, la culture laïque et chrétienne ensemble, la civilisation, nos livres sont dans un lieu « sacré ».
G.D. Cette initiative est-elle liée à une politique déterminée en faveur de la lecture dans l’école ?
A.J. La semaine qui a précédé l’inauguration de la bibliothèque a été l’aboutissement d’une grande « opération-lecture » dans l’école. On avait demandé que chaque professeur de Français choisisse un (ou une) écrivain belge et une œuvre de chaque auteur à faire lire par ses élèves. Tous les élèves de l’école ont donc lu un roman d’un écrivain belge. Nous avons invité dix de ces romanciers à venir dialoguer avec les élèves. Pour beaucoup ce fut une révélation : les jeunes ont compris un peu pourquoi et comment on écrit des romans et cela les incite à lire. Je crois vraiment qu’il faut périodiquement organiser des opérations de ce genre si on veut que les jeunes continuent à lire. Car en fait, beaucoup d’entre eux ne lisent pas parce qu’ils n’ont jamais été éveillés ou stimulés à la lecture. Mais à côté de ces initiatives extraordinaires je plaide aussi plus simplement pour la lecture d’un roman en classe, par exemple : quand c’est possible, à raison de quelques pages par semaine, cette lecture suffit à éveiller certains à ce plaisir. Quand il est lu avec expression, un roman n’est pas nécessairement ennuyeux. Je garde le souvenir de pareilles lectures, qui dans mon enfance furent extrêmement stimulantes.
G.D. Vous-même, êtes-vous un grand lecteur...?
A.J. Oui, je suis un grand lecteur, je lis tous les jours. Mais en vous citant mes auteurs de prédilection, je crains un peu de passer pour « un vieux de la vieille »...J’aime bien les romanciers du XIXème siècle : Flaubert, Zola, Maupassant, Balzac... J’ai aussi une vraie passion pour les romanciers russes : Dostoïevski, Tolstoï... et même la littérature russe contemporaine à laquelle m’initient des étudiants russes avec qui je suis en contact. Bref, j’aime beaucoup la grande tradition romanesque. Et j’avoue avoir un peu de mal avec la production actuelle en langue française que je trouve parfois un peu trop égocentrique, voire nombriliste. J’aime bien la narration, que l’on découvre le sens du roman par l’action, par les personnages. Sans doute ai-je tort de voir les choses ainsi, mais je le répète, j’aime bien un roman qui raconte quelque chose.
G.D. Un dernier mot : vos romans ont reçu de nombreux prix. Comment vivez-vous cette reconnaissance ?
A.J. Comme vous savez, il y a beaucoup de prix. Donc qui n’en a pas reçu, c’est qu’il n’a pas de chance... Plus sérieusement, ça fait évidemment plaisir. Mais il y a deux catégories de prix : ceux qui sont décernés par les professionnels (écrivains, journalistes...) et d’autres attribués par les lecteurs. Ces derniers sont évidemment les plus significatifs : recevoir par exemple en Belgique le Prix des lycéens (pour Helena Vannek en 2003) c’est être récompensé par 3000 élèves qui ont lu et voté. Cela signifie toucher un plus large public. Mais j’ai également été flatté d’avoir reçu le Prix Giono (pour Les fausses innocences), décerné par des académiciens en 2005..., d’autant plus que j’avais dévoré Giono avec passion pendant mon adolescence...
G.D. La fin des classes sonne. Je vous laisse à vos obligations... Merci, Monsieur Job pour le temps que vous avez pris à répondre si aimablement à toutes ces questions....
A.J. Merci pour vos questions... En fait, quand on m’interroge, j’apprends toujours beaucoup parce que je suis obligé de réfléchir à ce que je fais. J’ai écrit pendant longtemps un peu naïvement. Petit à petit au fil des rencontres j’ai dû formaliser : pourquoi fais-tu cela ? C’est maintenant que je commence à prendre davantage conscience de ce que je fais. Et en même temps, cela devient une espèce de consigne de travail : par exemple, je vous disais avoir constaté que je partais souvent de stéréotypes ; alors je me dis : « Méfie-toi, tu sais que tu es attiré par la caricature ! » Je n’en étais pas conscient avant d’en parler avec d’autres. D’où l’intérêt de dialoguer avec des gens qui apprécient mon travail ; ça me sert à moi aussi...Merci.
Propos recueillis par Gérard Durieux,
Bastogne, le 24 novembre2009
Coups de cœur
– Les fausses innocences, Laffont 2005.
– Baigneuse nue sur un rocher, Laffont 2001.
– Helena Vannek, Laffont 2002.
– Les mystères de Sainte Freya, Laffont, 2007.









